… mais aussi d’écriture, de disputes, de remises en question et de doutes, de sexe, de la vie quoi. Un inventaire à la Prévert ne suffirait pas à rendre la profondeur de ce que j’aimerais appeler un « roman télévisé », Girls, écrit par la jeune et talentueuse auteure américaine Lena Dunham. On y suit les péripéties d’une jeune femme, Hannah Horvath, qui cherche sa place dans son groupe d’amis, dans le tourbillon de la ville de New-York et plus largement dans le monde qui l’entoure. Au fil des évolutions capillaires de notre protagoniste, c’est une véritable saga qui se construit jusque là en cinq saisons (la sixième est à venir).
Se consacrer à l’écriture littéraire n’est pas chose aisée aujourd’hui, d’autant plus dans une société où la jeunesse peine à trouver sa place, un sens à la vie. La vocation littéraire d’Hannah est bel et bien le point de départ de la série et il s’agit d’un des fils directeurs de chacune des saisons. Entre demandes d’aide aux parents et petits boulots, entre écriture d’articles pour des magasines et enseignement, la jeune femme se perd dans les méandres du labyrinthe que représente la vie d’écrivaine aujourd’hui. D’autant qu’elle n’a pas encore rencontré le succès espéré… Mais Hannah n’est pas la seule, son monde est large et rempli de différents personnages, tous aussi importants les uns que les autres. Marnie, la meilleure amie qui se découvre sur le tard une vocation pour la musique folk. Jessa, l’amie d’enfance qui s’en va et qui revient, jamais trop loin de la fête. Elijah, l’ex-petit ami devenu homosexuel déjanté et confident de la jeune femme. Shoshanna, la cousine et colocataire de Jessa, à la recherche d’un moyen d’exprimer ses talents de communicatrice. Ray, amateur de littérature, ami un peu lointain mais qui n’hésite jamais à dire ce qu’il pense, dans toutes les situations. Et bien sûr Adam, le premier homme, le petit ami un peu barré mais surtout passionné de théâtre. Ils sont nombreux encore les personnages esquissés à la perfection tout au long de la série : les parents d’Hannah, Charlie, Daisy ou encore Natalia pour ne citer qu’eux. À la manière d’une grande écrivaine, Lena Dunham choisit de ne pas prendre seulement les traits d’Hannah mais selon moi, on peut la retrouver dans chacun de ses personnages sous la forme d’un trait de caractère, d’une mise en situation. Voilà sûrement la véritable force de cette série ! La mise en abîme initiale avec l’écriture sur la vie d’une écrivaine mène à un questionnement foisonnant sur la tension entre création artistique et vie sociale et économique, sur l’écriture romanesque d’un point de vue plus technique aussi, et plus largement sur le sens de l’existence, la quête de l’amour et les réalités de l’amitié. Empreinte d’un féminisme assuré, cette immersion dans le Brooklyn d’Hannah fait du bien par sa légèreté de ton autant que par sa profondeur de réflexion. Et puis, encore une fois, le développement d’un point de vue singulier pour chaque personnage nous entraine et nous donne cette sensation de liberté qu’il est aujourd’hui difficile de trouver dans des séries qui préfèrent se cantonner à faire entrer les personnages dans des cases et des repères parfois trop stricts et contraignants.
Que dire de plus sans dévoiler l’intrigue ou pour donner l’envie d’y jeter un œil ? Peut-être simplement cela : parfois, il apparaît nécessaire de couper avec les représentations de la violence, du pouvoir ou encore de l’Amour, pour retrouver la vie simple du quotidien. C’est tout le pari – et il est selon nous gagnant – de Girls et c’est pour cela que je vous conseille de regarder l’intégralité des cinq saisons dans la soirée ! Oups, n’allez peut-être pas jusqu’à l’indigestion mais dans tous les cas, passez au-delà des trois premiers épisodes qui peuvent être un peu troublants pour découvrir une série dont vous ne pourrez plus vous passer…
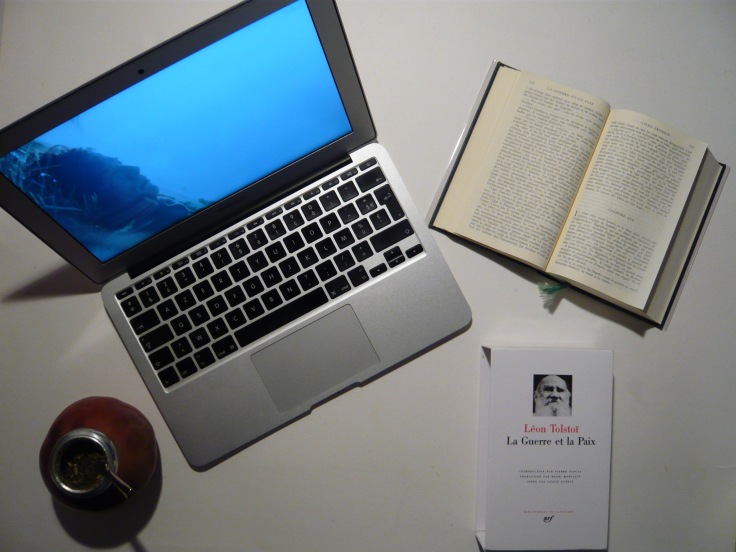
Commentaires récents